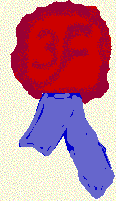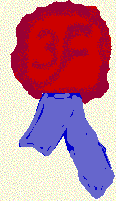
Le baron de Klinglin, descendant des dernières comtesses de Lutzelbourg, possédait la verrerie de Plaine de Walsch. Par manque de place il transfera cette verrerie en 1838 à Vallérysthal ou Val de Valléry, sur les terres qu'il avait hérités de sa mère et de sa tante par donation en 1820.
Dans cette verrerie il mis en place beaucoup d'oeuvres sociales pour le bien de ses ouvriers.
Entre temps il a tenu compte du sentiment religieux de ses ouvriers. Les églises les plus proches se trouvaient à Plaine de Walsch, à Biberkirch et à Walscheid, donc relativement loin pour les ouvriers habitant autour de l'usine.
Il installa donc une chapelle faisant fonction d'église et désservie par le curé de Plaine de Walsch. Elle n'a pas été installée dans un bâtiment construit à cet effet, mais aménagée dans le dernier étage d'un bâtiment dans lequel se trouvaient les écuries, à coté de la maison du maître. Dès la construction de ce bâtiment, tout était prévu. En effet cet étage supérieur avait des fenêtres à linteaux demi-ronds sur les deux façades. L'accès y était assuré du coté de la montagne par une passerelle et une porte d'entrée à linteaux demi-ronds comme les fenêtres. Il s'y trouvait en outre la salle d'école de la verrerie et le logement de la soeur enseignante.
Les cultes s'y faisaient dès 1831 car Caroline Pauline Arthémise fille du baron de Klinglin y célébra son mariage avec le comte Alexandre Bernard Simon de Menthon.
Mais l'usine prit rapidement de l'extension et la chapelle devint trop petite. Une chapelle plus grande devait donc être construite.
Ci-après l'extrait de "Verriers et Verreries de Antoine Stenger" concernant cette nouvelle chapelle dénommée "Chapelle St.Augustin".
La chapelle voit sa première pierre posée en 1884 après le départ exigé par la direction de l'usine du curé Pierre Clément arrivé début 1879. L'inauguration en présence du conseil d'administration de la société et de Monseigneur Fleck, Evêque de Metz, a lieu le 11 avril 1887. Elle continuera d'être desservie par le curé de Plaine de Walsch, comme l'était l'ancienne chapelle, malgré le désir du conseil de l'affecter à Biberkirch.
La construction de cette chapelle a été précédée de sérieuses mésententes entre les curés de Plaine de Walsch et le conseil de Vallérysthal. A l'origine, lorsque l'usine de Vallérysthal fut créée, le personnel y travaillant venait en majorité de Plaine de Walsch et le baron de Klinglin ne voyait aucun inconvénient à ce que ce soit leur curé qui continue d'officier à Vallérysthal. Mais lorsque en 1881 le curé demande la construction d'une nouvelle chapelle, le conseil de Vallérysthal refuse en soulevant le principe de l'appartenance de la chapelle à la cure de Plaine de Walsch et en demande le transfert à la cure de Biberkirch qui est beaucoup plus proche et présente moins d'inconvénients. Après le remplacement du curé Pierre Clément la construction fut autorisée. La chapelle continuera néanmoins à être desservie par le nouveau curé de Plaine de Walsch. Les pourparlers avec l'évêché de Metz continueront à ce sujet encore pendant 20 ans.
Elle est construite dans un style néo-gothique, usuel à cette époque, ayant les dimensions d'une église de campagne, avec une voûte en bois, peinte en calcaire à l'intérieur. Il n'y avait pas de chemin de croix, mais 14 croix le remplaçaient aux murs.
La nouvelle société créée pour la verrerie avait comme directeur M. Verdelet de religion protestante. Il y fit construire la tribune avec un orgue. L'intérieur fut peint et des statues furent installées. Il était vraiment oecuméniste.
Lors de la première messe du chanoine Reinstadt de Vallérysthal, le directeur Hanus fit rénover la Chapelle.
Sous la direction de M. Edmond Schweizer, le frère du célèbre Dr. Schweizer, Prix Noble et humaniste mondialement connu, le curé Greff de Troisfontaines fit installer les fenêtres colorées.
Puis le chauffage fut installé et l'autel dirigé vers les fidèles.
Pendant un certain temps cette chapelle eut même une mission oecuménique, car le pasteur Royer de Abreschviller y célébra le culte réformé pour les protestants de la vallée de la Bièvre
Le 30.1.1942 le curé de Walscheid, avec la permission de l'évêché se démit de ses fonctions religieuses pour les habitants de Sitifort en faveur du curé de Troisfontaines-Vallérysthal. Tous les actes religieux les concernant seront fait pour eux à Vallérysthal dans la chapelle. Le curé de Vallérysthal sera dorénavant aussi curé de Sitifort. Par lettre du 3.2.1942 la direction de la verrerie donne son accord pour la tenue du culte pour les habitants de Sitifort dans la chapelle dont elle était propriétaire.
En 1970 la Verrerie de Vallérysthal fusionna avec d'autres verreries pour former la "Compagnie Française du Cristal" Pour des raisons économiques, son Directoire décida la fermeture de la Verrerie de Vallérysthal et la mise en vente des tous ses immeubles y compris la chapelle.
D'abord, on a désaffecté la chapelle du culte et on projeta d'y installer un musée du verre et du cristal.Ce projet ne se réalisa pas. En plus la commune de Troisfontaines ne s'intéressa pas à la Chapelle.
Face à l'attachement de toute la population de Vallérysthal, Sitifort et Stossberg à cette chapelle qui a toujours été leur église, une association se créa sous l'impulsion de M. Georges Schlernitzauer, architecte. Elle prit la dénomination" Association St. Augustin de la Chapelle de Vallérysthal", régulièrement et juridiquement constituée et enregistrée au Tribunal en 1973. Elle acquit la chapelle pour le franc symbolique.
Pour restaurer la chapelle, il fallut refaire entièrement la couverture et la zinguerie, renouveler le crépi extérieur et la peinture, aménager un nouvel escalier d'accès, restaurer les installations électriques , refaire les peintures intérieures et installer un nouveau système de chauffage et enfin aménager un chemin d'accès carrossable.
Le financement des travaux incomba exclusivement à l'association. Pour se procurer les fonds nécessaires elle fit appel à la générosité des fidèles, organisa des kermesses et des soirées privées. Elle continua à organiser une mini-kermesse, chaque année au premier mai, le jour de la fête du travail.Selon l'heureuse initiative de feu M. le curé Bertholin, la chapelle devint un lieu de pèlerinage en l'honneur de St.Joseph le patron des ouvriers.
Les dépenses s'élevèrent à 305886 Frs
Une violentes tempête démolit le clocher en 1991. Il qui a du être refait au prix de 186613 Frs, somme qui fut compensée en majeur partie par l'assurance.
Il faut aussi signaler qu'à la chapelle est déposée la truelle ayant servi à la pose de la première pierre avec l'inscription suivante: "Souvenir de la pose de la première pierre de l'Eglise de Vallérysthal 1884". Cette truelle a été remise par Mme Paulette Zell, née Ecker dont l'ancêtre, chef Maçon,dirigea les travaux du gros-oeuvre.
L'orgue de la Chapelle.
Une description détaillée nous est donnée dans l'étude "Orgues de la Moselle".
L'orgue qui se trouve sur la tribune au-dessus de l'entrée a été construit vers 1898 par Franz Staudt. La chapelle étant propriété privée à l'époque de la construction de l'instrument, il n'y a plus de documents. En effet ceux-ci se trouvaient dans les archives de la verrerie et qui ont disparu. Signé par Franz Staudt, cet orgue fut probablement posé quelques années après l'achèvement de la chapelle, vers 1898. Grâce à ce statut de propriété privée, les tuyaux de façade échappèrent à la réquisition de 1917. A L'exception de la pose du ventilateur électrique, l'orgue Staudt n'a pas subi la moindre altération et est parvenu intact jusqu'à nous. Un relevage été effectué en 1992 par Freddy Bauer pour la somme de 69452 Frs.
Le buffet a une boiserie néo-gothique et se compose d'une façade en chêne et de parois latérales et arrière en sapin. Elle encadre la rosace, mais en un seul corps. Il n'y a jamais eu de plafond.
Les tuyaux de façade sont en étain avec écussons rapportés en plein ceindre. Ils sont encore de Staudt.
La composition de l'orgue:
1- Grand -orgue (56 notes)
Bourdon 16
Montre 8
Flûte harm. 8
Gambe 8
Prestant 4
Dulciana 4
2- Récit expressif (5- notes)
Flûte Bouchée 8
Salicional 8
Vax Celestis 8
Octavin 2
Trompette harm. 8
Pédale (27 notes)
Sommiers à pistons de Staudt avec un petit soufflet par piston.
1 sommier pour le grand orgue diatonique
1 sommier pour le récit diatonique.
1 sommier pour la pédale chromatique
La console indépendante est tournée vers le choeur et est entièrement d'origine.Claviers en tilleul, frontons à angle droit au grand orgue et biseautés au récit. Naturelles plaquées de matière synthétique blanche feintes en ébène. Pédalier droit en sapin. Tirage des jeux par tirants de section ronde,placés au-dessus des claviers, avec porcelaine blanche et lettres noires au grand-orgue, rouges au récit et vertes à la pédale Il s'y trouve une plaque en porcelaine blanche, indiquant:
"Frac. Staudt Facteur d'orgues à Puttelange (Lorraine)"
La transmission est pneumatique tubulaire pour les notes et les jeux, avec tubes en laiton et non en plomb.
La tuyauterie bien que livrée par Staudt dès l'origine, est de quatre provenances différentes:
- tous les tuyaux de bois ont été fabriqués par Staudt
- la plupart des tuyaux en métal ont été commandés chez Walcker, avec écussons en ogive et nom du jeu poinçonné en demi-cercle;
- La Dulciana 4 est le seul jeu en métal fabriqué dans les ateliers mosellans, de facture typique des Verschneider, mais avec des marques à la pointe sèche caractéristiques de l'entreprise de Rémering et non de Puttelange,
- la trompette 8 est de facture parisienne.
Le diapason est La à 435 Hz.
La soufflerie est à Réservoir à plis compensés dans les sousbassement. Elle est alimenté par un ventilateur électrique ou par des pompes actionnées par un levier en métal situé à l'arrière de l'orgue.
Le curé M. Jean Paul Berlocher trouve cet orgue meilleur que celui de Troisfontaines.